
Traduit de l’italien
MUTINES SÉDITIONS
Edition originale :
Belgrado Pedrini
« Noi fummo i ribelli, Noi fummo i predoni...»
Schegge autobiografiche di uomini contro
Edizioni Anarchiche Baffardello
Carrara 2001
Mutines Séditions
c/o Bibliothèque Libertad
19, rue Burnouf
75 019 Paris
http://mutineseditions.free.fr
mutineseditions@riseup.net
© NO COPYRIGHT
Aucun droit, aucun devoir
1ère édition : novembre 2005
2e édition revue et corrigée : août 2011
Un certain goût pour la liberté
C’est l’histoire d’un jeune homme autodidacte de 18 ans qui
s’engage dans la lutte révolutionnaire. Nous sommes en 1931, et
le parti fasciste est alors installé aux commandes de l’Etat italien
depuis près d’une dizaine années. C’est l’histoire d’un anarchiste
qui s’arme contre lui bien avant 1943, année du débarquement
anglo-américain en Sicile, de la chute provisoire de Mussolini et
des débuts officiels de la Résistance. Bien avant 1941 aussi, et la fin
de la trêve entre le fascisme brun et le fascisme rouge liée au pacte
germano-soviétique. Cette même trêve qui avait par exemple conduit
le Parti communiste italien, inféodé à Togliatti, à proposer dès
le début des années 30 à ses militants d’infiltrer les indispensables
structures de masse créées par les fascistes pour un jour les retourner
à son propre service.
Un jour… L’attente dans une nuit sans fin, en cette période qui
précède le second conflit mondial. Des poignées d’hommes courageux
et déterminés sont pourtant prêts à risquer le tout pour le tout
plutôt que de continuer à survivre sous un tel régime. Comme sous
n’importe quel régime d’ailleurs, dès lors qu’il est placé sous le règne
de l’Etat, de l’exploitation ou de la marchandise.
C’est l’histoire d’un condamné qui, attendant son exécution
dans la prison de Massa avec ses compagnons pour avoir tué des
fascistes, est libéré avec tous les autres par un groupe de partisans
en juin 1944. C’est l’histoire d’un combattant qui ne dépose pas
les armes à la libération du territoire national. C’est l’histoire d’un
ex-partisan de 32 ans qui est arrêté en mai 1945 et condamné quatre
ans plus tard à 30 ans de prison, accusé d’avoir tué un policier
et d’expropriations au détriment d’industriels fascistes de Carrare,
Un certain goût pour la liberté
• 6 Nous fûmes les rebelles... Milan et La Spezia. Délits de droit commun, car commis avant
1943, et par des anarchistes. Condamné, tout comme des centaines
d’autres ex-partisans qui ne sont pas disposés à accepter les joies de
la démocratie imposées par le Parti communiste et les partis bourgeois
chrétiens ou réformistes. C’est l’histoire d’un prisonnier qui,
de tentatives d’évasion en mutineries collectives, ne sort de l’enfer
carcéral qu’au milieu des années 70, en toute fin de peine. C’est,
enfin, l’histoire d’un révolté qui continue ensuite à user de toutes les
armes de la critique, de la fondation du Circolo culturale anarchico
(bibliothèque populaire) et du Circolo Bruno Filippi à Carrare, de
ses articles dans L’amico del popolo, jusqu’à son appui au groupe de
lutte armée libertaire Azione Rivoluzionaria (1976-1979).
Cette histoire aurait pu être le résumé de la vie de Belgrado
Pedrini, qui a commencé à en consigner quelques éclats avant de
mourir en février 1979. Il les a malheureusement laissés inachevés,
confiant à un ami le soin d’en faire… ce qu’il en voulait !
Pedrini fut un de ces êtres dont on aime à connaître le parcours,
un de ceux qu’on peut aisément citer comme exemple presque
définitif dans une conversation qui touche à la continuité de
l’engagement. Pour sa radicalité, ou pour sa ténacité. Ce récit, qui
peut désormais voguer de ce côté-là des Alpes, rencontre pourtant
précisément toute sa limite lorsqu’on procède à une lecture aussi
partielle de la présente traduction de ses mémoires.
Comme pour les milliers d’individus qui ont combattu lors de la
guerre d’Espagne avant-guerre, et dont il ne reste trace qu’à travers
la reconstruction des biographies des plus connus d’entre eux, on
sait bien peu de choses des milliers d’anarchistes italiens qui se sont
lancés à corps perdu dans la lutte pour la liberté au cours des années
20 et suivantes.
Parce qu’ils n’en ont pas eu le temps. Parce qu’ils ne savaient ou
ne voulaient pas écrire. Parce que l’oralité conserve une saveur particulière
qu’aucun texte ne peut rendre sans la dénaturer, et porte
en elle l’intimité propre à un rapport vivant. Parce que la mémoire
des défaites est toujours plus difficile à transmettre. Parce que bien
peu d’oreilles avaient envie de les écouter.
A ce titre, les fragments qu’a laissé Pedrini nous sont précieux. Ils
nous offrent la possibilité de recevoir, au-delà des frontières et des
années, un peu de l’expérience et de l’humanité d’un compagnon
qui a su affronter le monde avec ses moyens. Un monde qui a certes
un peu changé, mais qui plonge ses racines dans les mêmes eaux
glacées de la domination.
Ses fragments ne sont ni une longue succession de hauts faits
d’armes qui nous renverraient à une époque lointaine où on pouvait
encore forcer les engrenages adverses et porter des coups significatifs
à l’ennemi, ni une mise en scène auto-complaisante. L’auteur
est suffisamment sincère et entier pour laisser libre cours à ses appréciations
ou pour tenter, à l’aune de sa seule vie de révolté, une
brève analyse de quelques mécanismes de la servitude volontaire
carcérale.
C’est aussi un témoignage sur des compagnons oubliés ou disparus,
sur une lutte et un engagement toujours actuels. Non pas
pour encourager artificiellement et de manière rhétorique les compagnons
d’aujourd’hui à continuer le combat, mais parce que, des
années 30 à la fin des années 70, dedans comme dehors, Belgrado
Pedrini les a vécus et partagés ainsi.
On ne s’étonnera donc pas de trouver dans le texte cette forme
d’idéalisme d’une génération qui portait en elle de façon bien
vivante les luttes sanglantes du prolétariat de la fin du siècle précédent,
et la diffusion des idées anarchistes de l’époque de Malatesta.
Ni de rencontrer parfois une rigidité qui le porte à parler durement
de ses compagnons d’infortune en prison. Une attitude que l’on
ne peut comprendre que dans le contexte de l’époque (les prisons
des années 50 et 60 d’avant les grandes mutineries), et qu’à travers
le parcours d’un rebelle rétif aux compromis, dont la captivité fut
rendue plus rude encore par la soumission diffuse qui l’entourait, et
Un certain goût pour la liberté...
• 8 Nous fûmes les rebelles... l’isolement dans lequel il se trouvait. Cette situation ne le conduit
pourtant pas à désespérer. Car s’il est bien une chose que Pedrini
conserve tout au long de ces années, c’est l’espoir. Non pas l’espérance,
qui confine à la foi religieuse ou se confond avec l’attente des
lendemains qui chantent, mais l’espoir d’une libération totale, individuelle
et collective, vécue comme un possible à portée de main.
Un possible à conquérir.
Nous n’avons pas voulu gommer ces aspérités par une traduction
complaisante, car nous y voyons des complexités qui font de Pedrini
non pas un personnage historique, mais un individu dans toute
la richesse de son irréductible humanité, et un compagnon de route
auquel nous nous attachons par ces liens mystérieux qui peuvent
parfois unir une génération à l’autre.
Le temps de l’affrontement armé contre le fascisme est devenu
un sujet de roman noir ou l’occasion de fêter le bonheur de l’exploitation
pacifiée. Le capitalisme démocratique ne s’en sert plus que
comme épouvantail lorsqu’il s’agit de resserrer les rangs, et l’on voit
même à l’occasion réapparaître la figure des incontrôlés espagnols ou
des bandits italiens, bien sûr dépouillés de leur qualité de révolutionnaires.
Ce que nous entendons nous à travers ce dernier terme,
ce n’est ni le sens générique du mot, ni les formes institutionnelles
qui s’en revendiquent. C’est cette aspiration qui a donné aux trop
rares Pedrini une raison de vivre, la force d’affronter —la rage au
coeur et l’arme au poing— un ennemi qui se présentait alors sous
le visage du fascisme. Sans attendre, par tous les moyens cohérents
avec leur éthique individuelle, au nom d’une liberté basée sur
l’autonomie et la réciprocité.
Ce qui caractérisait alors une partie des partisans, a fortiori les
anarchistes, ce n’était en effet certainement pas l’antifascisme tel
que les démocrates et les staliniens de toujours peuvent à présent le
dépeindre. C’était au contraire, un certain goût pour la liberté. Les
chaînes qu’ils se sont évertués de briser n’étaient pas que celles d’un
régime particulièrement infâme pour tout esprit un tant soit peu
critique, mais celles qui réduisent une vie à la condition d’exploité,
et la liberté à un choix entre différentes oppressions. Il ne s’agissait
pas pour eux de ne libérer qu’une seule portion de terre d’une occupation
étrangère, comme les colonisés en ont fait l’amère expérience
après 1945, mais de détruire tous les Etats et leurs frontières dans
une perspective internationaliste. Tout comme il ne s’agissait pas
pour eux de ne s’attaquer qu’aux seuls exploiteurs collabos, mais
bien de détruire tous les rapports de domination dans une perspective
antiautoritaire.
Pedrini n’a en effet été « partisan » que parce que le régime se
nommait « fasciste » ; c’est l’Etat et le pouvoir en soi qu’il combattait.
Il n’a été « mutiné » que parce que les murs qui le retenaient se
nommaient « prison » ; ce sont toutes les structures qui emprisonnent
la liberté au nom de la justice ou de la raison (comme les asiles,
contre lesquels il a écrit plusieurs textes) qu’il combattait. Il n’a été
« expropriateur » d’industriels fascistes que parce que l’argent dont
il avait besoin pour lutter était concentré là ; c’est le système capitalisme,
même dévêtu de sa chemise noire, qu’il combattait. Il n’a été
« terroriste » —comme l’Etat nommait ceux qui entendaient monter
à l’assaut du ciel dans les années 70, avant d’étendre le sens du
mot à toute dissidence radicale— que parce que c’était le langage
d’une critique pratique qui en appelait tant d’autres.
Au-delà des formes d’organisation qui privilégient toujours
l’autonomie et l’affinité (les actions individuelles clandestines avant
1943, les formations autonomes de partisans jusqu’en 1945, les
évasions à petit nombre ou les mutineries en fonction des possibilités
lors de sa longue incarcération, l’appui aux groupes affinitaires
coordonnés au sein d’Azione Rivoluzionaria à la toute fin de sa vie),
Pedrini n’a privilégié aucune forme de lutte. La distribution de manifestes
clandestins et le collage d’affiches était le complément nécessaire
aux actions armées contre les fascistes. L’écriture —de tracts
avant la prison, de poésies en galère ou d’articles à sa sortie—, n’a
par exemple jamais été considérée comme une activité secondaire.
L’agitation, qui voulait dire pour l’anarchiste participer à sa façon et
être ouvert aux transformations sociales en cours, avait pour objectif
une révolution anti-autoritaire pour toutes et tous.
L’antifascisme est souvent une idéologie bien commode, d’une
part pour amener une partie des dominés à une collaboration de
classe, d’autre part pour se dissocier de perspectives qui ne se limiteraient
pas à viser tel ou tel aspect du fascisme, mais tenteraient
d’analyser —et donc de frapper— l’expression même du pouvoir.
Et ce, quelles que soient les formes historiques dont il se pare (en
agissant par exemple hors des périodes de « front uni » ou à l’extérieur
des « dictatures concernées »). Face à de telles perspectives
pratiques, s’évanouit en général immédiatement l’alibi antifasciste,
alibi qui résonnait jusque-là comme une sorte d’autorisation morale
de se lancer dans une lutte féroce contre l’Etat et ses serviteurs.
Nombre d’antifascistes sont alors pris de doute, finissant par se
demander si c’est vraiment le moment d’attaquer, s’il n’existe pas de
moyens de mener une autre forme de lutte contre le pouvoir, une
lutte sinon réformiste, mais au moins capable de prendre en compte
les degrés répressifs qu’une démocratie est toujours en mesure de
proposer à ses adversaires. Une grande partie de ces antifascistes
soudainement dubitatifs finit souvent par abandonner ceux qui
continuent de lutter avec acharnement contre la domination, et
sans le moindre respect pour les périodes historiques officielles
(après 1945 pour les Français ou les Italiens, ou 1990 pour les
Chiliens par exemple).
Des quelques lignes que nous a laissées Pedrini, émergent
d’autres parcours qui viennent nous rappeler la continuité de
compagnons qui n’ont pas limité leur engagement radical à la seule
résistance tolérée contre le virage fasciste du capital. Giovanni Mariga,
vice-commandant de la formation partisane « Elio », fut condamné
à perpétuité en 1946, accusé du meurtre d’un ex-secrétaire
du parti fasciste commis après-guerre. Il est sortit de prison en 1968
à l’âge de 69 ans, après 22 ans de galère. Giovanni Zava, un autre
11 •
partisan carrarais, est sorti de prison en 1974, après 29 ans de galère,
accusé des mêmes délits que Pedrini : meurtre d’un policier en
1942 et expropriation d’industriels fascistes. Elio Wochiecevich, le
commandant de la formation de partisans qui a porté son nom, sort
de prison à la fin des années 60 après avoir purgé 10 années, accusé
d’être l’auteur d’un attentat accompli dans l’immédiat après-guerre
contre une caserne de CRS à Carrare. Goliardo Fiaschi, anarchiste
engagé dans la Résistance à l’âge de 13 ans, est arrêté le 30 août
1957 à Barcelone en compagnie de l’espagnol Luis Agustín Vicente.
Avec José Lluis Facerías, assassiné le même jour par la police,
il faisait partie d’un groupe de guérilleros urbains italo-espagnol
retourné affronter le fascisme de l’autre côté des Pyrénées. Condamné
à 20 ans de prison, il sera extradé vers l’Italie en 1965. Là,
il effectuera une peine de 13 ans de prison, accusé d’un braquage
commis en 1957 à Casale Monferrato afin de financer les actions
antifranquistes. Fiaschi ne sortira de galère qu’en 1974, 17 années
après son expédition ibérique.
Enfin, au-delà de ces quelques compagnons que Pedrini a continué
de croiser dans les différentes geôles italiennes et avec lesquels il
a parcouru le chemin sinueux de la révolte, il y a toutes les actions
accomplies par les anonymes. Celles dont il ne reste volontairement
pas de traces écrites, parce que leurs auteurs sont restés à l’ombre
des projecteurs de la justice, hors de portée des griffes des nouveaux
bourreaux démocratiques. D’expropriations en gestes explosifs,
une partie des anarchistes qui avaient eu l’occasion de combattre
la domination sous le fascisme n’ont pas mis un terme à leur vie
d’irréguliers et à leur soif de liberté.
En ce qui concerne les autres compagnons, plus connus du lecteur
italien, on ne rappellera ici que la mémoire de quelques uns :
ceux qui ont décidé de frapper de là où ils étaient, en exil, alors
qu’ils auraient pu profiter des quelques garanties formelles offertes
par les démocraties qui les avaient accueillis bien malgré elles (rappelons
que des milliers de républicains Espagnols furent incarcérés
dans des camps de concentration du sud de la France dès 1939, et
que nombre d’Italiens furent expulsés) et se contenter des pétitions,
manifestations et autres comités unitaires.
Le 3 septembre 1923 à Paris, Mario Castagna, attaqué par un
groupe de fascistes, sort son revolver et élimine l’un d’eux, Gino
Jeri. Il sera condamné en juillet 1924 à 7 ans de prison. En février
1924, se produisent une série d’attentats en France contre les sièges
du parti fasciste et les consulats italiens. Le 20 février 1924 dans
un restaurant parisien, Ernesto Bonomini tue de plusieurs coups
de feu Nicola Bonservizi, responsable du parti fasciste à l’extérieur,
correspondant du Popolo d’Italia et rédacteur du journal fasciste de
Paris, L’Italie Nouvelle. Devant la cour d’assises de la Seine qui le
condamnera à 8 ans de prison, il précisera ne pas combattre uniquement
le fascisme italien : «Je suis anarchiste, c’est-à-dire ennemi
de tous les despotismes, ennemi de l’Etat, ennemi de la propriété privée.
Je suis un rebelle, et ma rébellion ne s’exerce pas contre les crimes d’une
seule autorité, mais contre tous les crimes de l’autorité». Le 15 septembre
1927, le jeune anarchiste Di Modugno se rend au consulat
italien de Paris et assassine le comte Nardini, vice-consul en poste.
Le 22 août 1928, le marquis Di Muro, consul d’Italie, est blessé par
une attaque anarchiste à St Raphaël. Le 8 novembre 1928, Angelo
Bartolomei tue à coups de revolver le prêtre fasciste don Cesare
Cavaradossi, vice-consul de Nancy, qui lui avait proposé de devenir
une balance pour éviter l’extradition. Il réussira à échapper à la
police et à se réfugier en Belgique. Arrêté l’année suivante, il revendiquera
son geste et finira par ne pas être extradé en France grâce
à une vive campagne de protestation. Il sera remis en liberté le 28
février 1930, et expulsé de Belgique. En 1928, une grenade explose
contre un siège du parti fasciste de Juan-les-pins : Malaspina est
arrêté et torturé en prison avant d’être acquitté, faute de preuves. Il
mourra l’année suivante à Paris des suites de ce séjour forcé. Le 20
mai 1930, l’anarchiste Gino D’Ascanio est condamné à 15 ans de
travaux forcés au Luxembourg. Déjà expulsé de France, de Belgique
et de Hollande, sans papiers, il s’était rendu au consulat italien du
13 •
Luxembourg pour en obtenir. Devant le refus de sa requête par un
employé fasciste du lieu, il l’avait abattu de plusieurs coups de feu.
Le 12 août 1931, le vice-consul fasciste G. Zurattini est tabassé par
deux jeunes dans une rue de Bruxelles. Le 14 janvier 1932, une
bombe lancée par l’anarchiste Pietro Cociancich rase le siège de
l’Union des anciens-combattants italiens à Aubagne (Marseille). Il
sera condamné l’année suivante à 5 ans de prison.
En plus de ces quelques compagnons italiens qui ont agi individuellement
par choix ou suite à une analyse de l’absence de réaction
« des masses » —selon l’expression de Pedrini—, nombre d’entre
eux ont participé aux groupes de partisans qui se sont développés
outre-Alpes à partir de la fin 1943. Limités numériquement, ils
étaient en général intégrés aux brigades Garibaldi (liées au parti
communiste) ou Matteotti (liées au parti socialiste), bien que plusieurs
aient réussi à constituer des groupes disposant d’une relative
autonomie. Mais à la fin de la guerre, comme cela s’était déjà produit
au sein des formations antifascistes espagnoles en 1937 lorsque
les communistes ont entrepris de militariser les milices, la plupart
des formations autonomes de partisans anarchistes ont à leur tour
subi le changement de cap des cadres staliniens. Il visait cette fois
à transformer leur lutte révolutionnaire en une lutte de libération
nationale, afin de ne rétablir qu’un ordre bourgeois différent.
On trouve par exemple des groupes anarchistes au sein de la 28e
Brigata Garibaldi dans la zone de Ravenna, au sein de la Divisione
Garibaldi-Friuli dont le premier noyau fut libertaire, au sein de la
formation « Silvano Fedi » autour de Pistoia (53 hommes), au sein
des brigades « Malatesta-Pietro Bruzzi » (1 300 hommes) intégrées
aux formations Matteotti à Milan, au sein de la 23e Division autonome
« Sergio De Vitis » à Turin, au sein des brigades « Pisacane » et
« Malatesta » (400 hommes) à Gênes, au sein des formations autonomes
« Michele Schirru », « Gino Lucetti », « Elio » et « Lunense »
coordonnées dans la Brigata Apuana autour de la région de Carrare.
En outre, on peut citer pour mémoire le cas de certains anarchistes
qui ont fini par occuper des responsabilités au niveau national,
comme Emilio Canzi à Piacenza, qui s’est retrouvé à la tête de trois
divisions et 22 brigades (soit plus de 10 000 hommes), ou Giovanni
Domaschi qui, après 11 années de prison, 9 années de mise au banc
et deux évasions, devient le fondateur du Comité de Libération Nationale
de Vérone (instance locale coordinatrice de la Résistance),
avant d’être arrêté et de mourir en déportation à Dachau.
Aujourd’hui, suite notamment à la liquidation de la tempête
sociale des années 70 qui a porté une possibilité inachevée mais
toujours féconde (et dont les premières armes ont été fournies par
d’anciens partisans), l’Etat est parvenu à prendre une bonne longueur
d’avance sur les révolutionnaires. On pourrait ainsi décrire à
l’infini les instruments militaires, technologiques ou législatifs qu’il
affine. Cependant, une de ses plus grandes victoires reste la paix
sociale qui s’est imposée de force contre les rebelles, avec la résignation
ou la complaisance d’une bonne partie de la population.
Mais tout n’est pas si solide. Même le vieux verbe creux des gauches
s’est épuisé au contact de leur misérable opposition, voire de
leur excellente gestion de la domination. L’idéologie sécuritaire, qui
prend prétexte des illégalismes de la survie et de quelques actions
spectaculaires qui touchent parfois l’Etat et ses sujets, se développe
surtout afin de maintenir par la peur des conditions d’exploitation
que le développement du capitalisme rend toujours plus âpres dans
cette partie du monde. Le meilleur exemple en est la politique
contre les immigrés : il ne s’agit pas de les expulser réellement tous,
mais bien de les précariser ici par la matraque et la crainte des contrôles,
afin de les mettre au travail dans des conditions proches de
celles qu’ils ont fuies (citons simplement les secteurs du bâtiment,
du textile et de la restauration qui en vivent largement). Enfin, le
retour en force de la figure du « terroriste », avec sa définition toujours
plus extensive qui englobe toute perturbation de l’ordre social,
politique et économique –même minime comme l’occupation
ou la grève sauvage–, est le symptôme d’une logique répressive qui
reste l’arme ultime de toujours pour tenter de faire rentrer de force
15 •
les bras et les têtes dans l’infini bonheur de la marchandise lorsque
le coeur n’y est plus.
Ces dernières années, de nombreux anarchistes italiens ont
continué d’être incarcérés, sous le coup notamment de l’accusation
d’association « subversive » ou « de malfaiteurs » (du procès national
Marini en 1996 aux opérations Cor à Pise en 2004, Cervantes à
Viterbo/Rome en 2004, Nottetempo à Lecce en 2005 ou Outlaw à
Bologne en 2011). Le prétexte en est souvent des sabotages réussis
qui ont frappé l’Etat (prisons, casernes, mairies, tribunaux, sièges
de partis politiques ou syndicaux) ou des structures économiques
(agences d’intérim, immobilières, banques, pylônes électriques,
laboratoires de recherche) et parfois blessé leurs serviteurs. Pourtant,
malgré un encadrement des manifestations qui s’exprime avec
moins de tact (de Gênes en juillet 2001 au Val Susa), un quadrillage
policier des quartiers populaires dans les grandes villes renforcé par
des unités militaires (avec son lot de rafles et d’exécutions), des
conditions d’incarcération où l’isolement total devient la norme
pour toujours plus de prisonniers, une gestion sans concession des
grèves sauvages ou la multiplication arrogante de nervis au crâne
rasé, il resterait erroné de parler d’un retour du « fascisme », et par
conséquent d’une nécessaire entrée en « résistance ». Le capitalisme
a en effet plus que jamais dépassé la fausse opposition fascisme/
démocratie, pour parvenir à un système total où on peut moins
que jamais affronter un de ses aspects sans remettre l’ensemble en
question. Où s’opposer réellement signifie pour tous se poser en
ennemi.
Une lecture hagiographique de ce livre en constituerait le mode
le plus simple, et le moins intéressant. Dans l’étrange période
où nous vivons, face à l’écrasement continu, la seule perspective
collective ne serait plus d’affronter l’existant à bras le corps. Elle
se trouverait en revanche soit à travers un citoyennisme qui pousse
à la réappropriation des instruments de domination (un meilleur
Etat, des lois plus justes, un marché plus régulé, une démocratie
réelle, etc.), soit à travers une désertion stratégique de l’antagonisme
quotidien (pour mieux s’organiser ou préserver ce qui peut encore
l’être, au choix). Dans un tel contexte, il n’est alors guère surprenant
que les éclats de vie du passé servent toujours davantage à
justifier l’inactivité contemporaine, en s’enfermant dans le culte de
la charogne comme en s’évertuant à démontrer que les conditions
objectives ont changé. Ou bien, à l’inverse, ils servent à mythifier
les seuls faits, les actes en soi, oubliant volontairement l’esprit qui
les rendait brûlants, et pas simplement au service de challengers de
la domination.
Une lecture idéologique faisant de Pedrini un exemple à suivre
ou admirer plutôt qu’un parcours de révolte à partager et critiquer,
le priverait alors de toute sa nécessaire complexité. De la même
façon qu’une lecture privilégiant la seule belle geste enlèverait toute
force à un compagnon qui, s’il a toujours tenté de s’exprimer sans
compromis, le fit cependant dans une confrontation permanente
guidée par sa haine des oppresseurs et son amour de la liberté.
Ce qui nous a, quant à nous, poussés à publier ce récit, au-delà
des raisons de coeur et d’esprit, c’est la continuité révolutionnaire
d’un compagnon qui nous inspire encore au présent, d’un individu
insurgé contre l’ordre entier de ce monde.
Et c’est peut-être même la vivacité de ses aspirations qui lui a
donné la possibilité de rester cohérent avec son éthique.
Aujourd’hui comme hier
1. Concernant l’activité des anarchistes contre le fascisme, on peut consulter
pour information : Collectif, La resistenza sconosciuta, Zero in condotta (Milan),
2d ed. 2005, 206 p. et surtout Pietro Bianconi, Gli anarchici italiani nella lotta
contro il fascismo, edizioni Archivio Famiglia Berneri (Pistoia), 1988, 200 p. &
Un trentennio di attività anarchica (1914-1945), edizioni L’Antistato (Cesena),
1953, 216 p.
Nota Bene : Toutes les notes du livre sont des traducteurs. Les ouvrages qui y sont
mentionnés ont pour objectif de satisfaire le lecteur curieux.


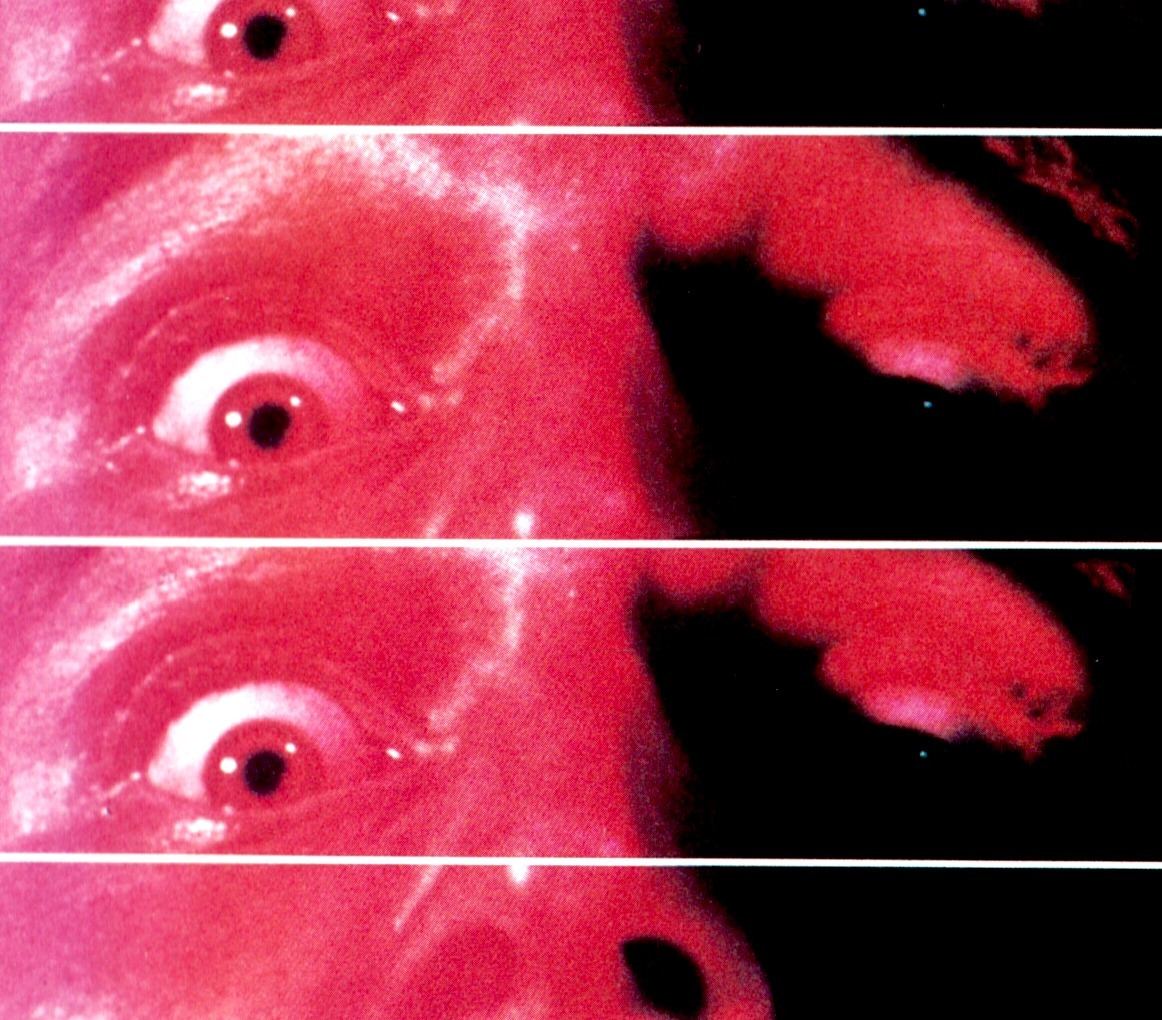
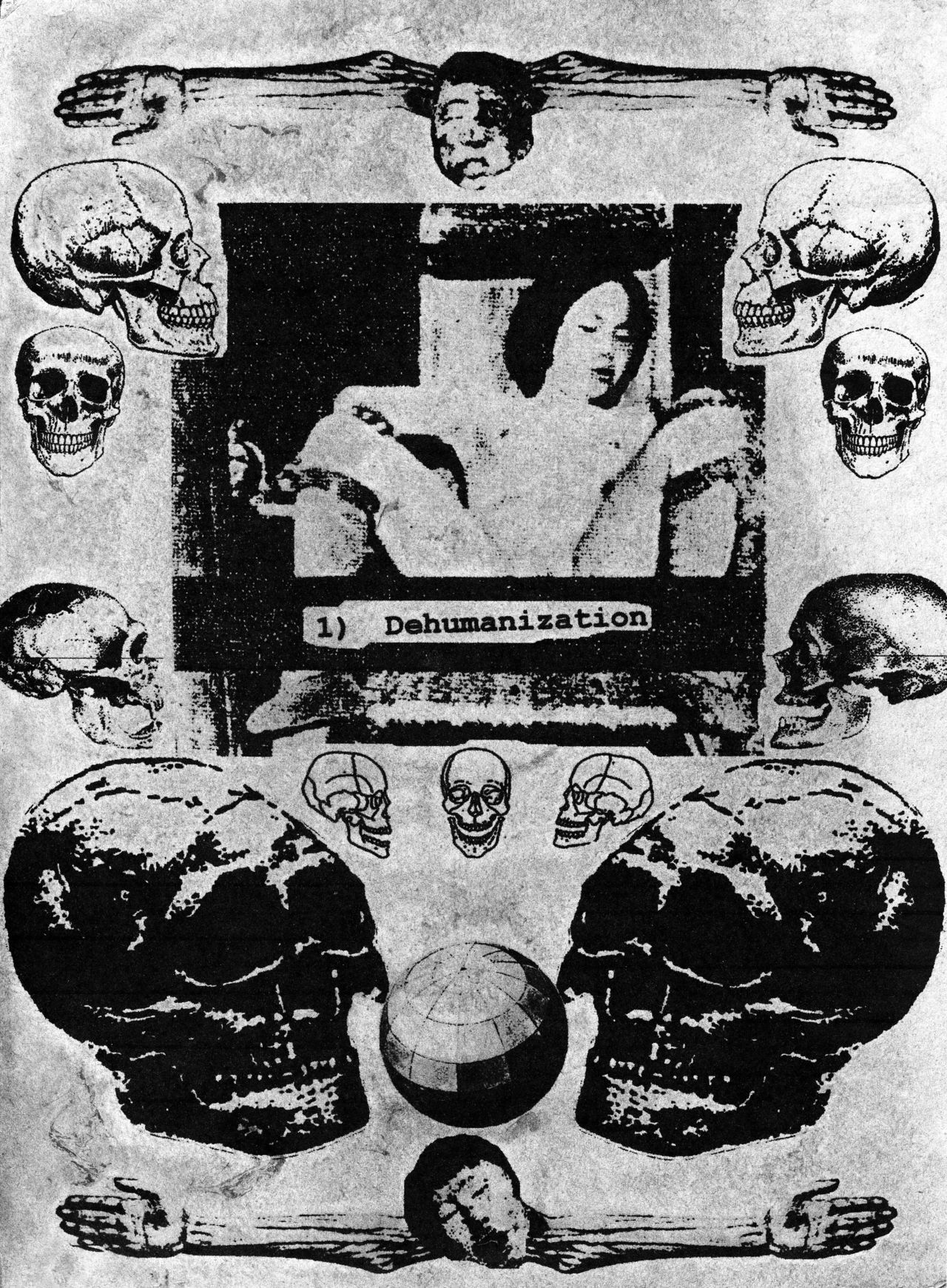



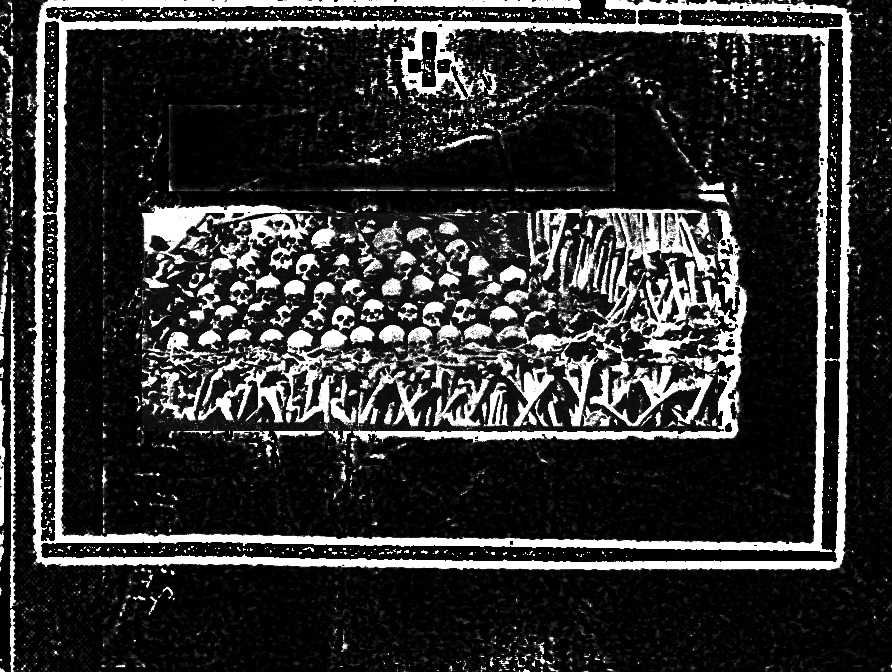




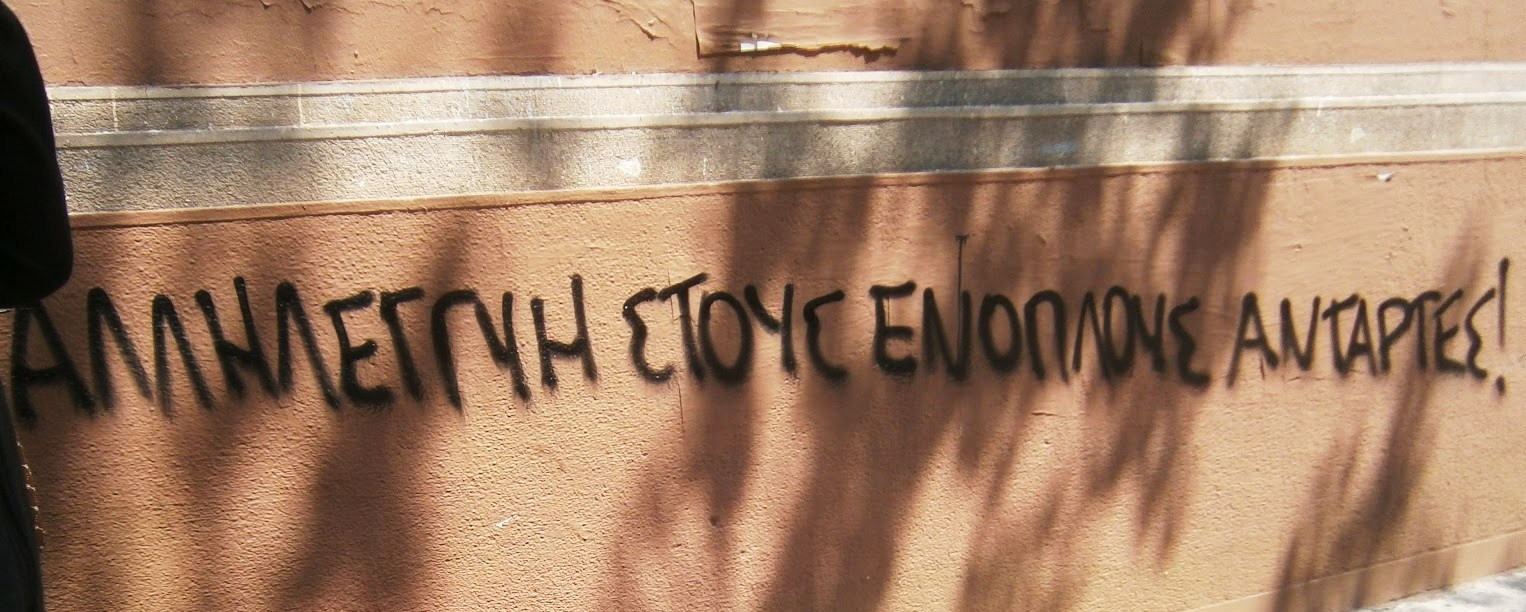

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)



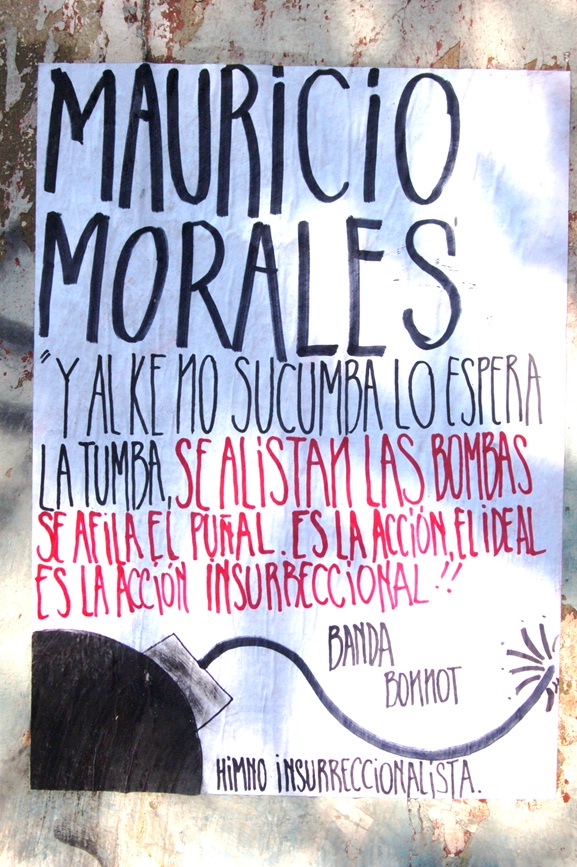
![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)









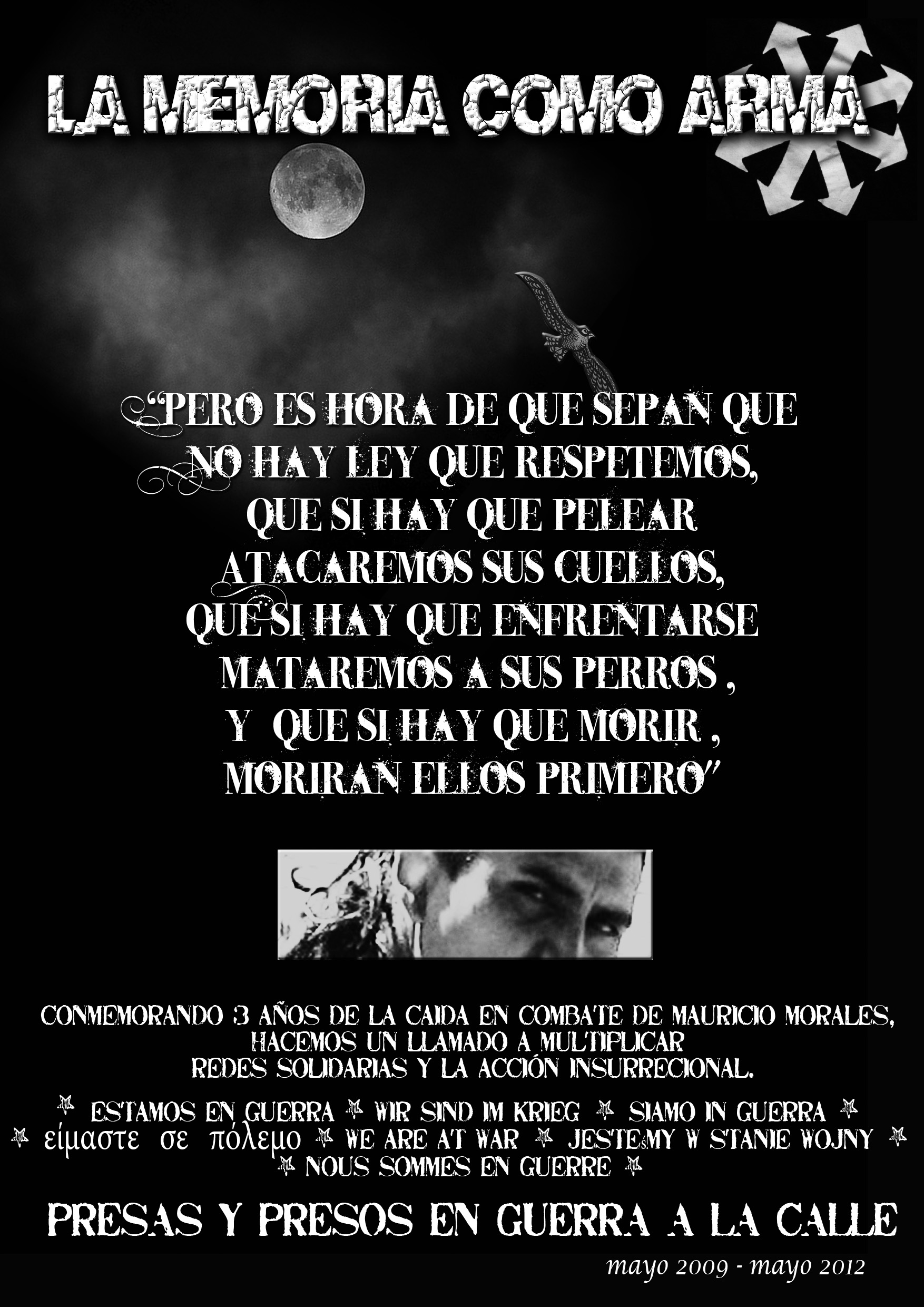









Nessun commento:
Posta un commento