
- I -
Les deux sources de l’absurdité
1. L’absence d’eidos du travail
Ce n’est vraiment pas sans raison que nous parlons de l’« absurdité de la vie actuelle ». Ce que nous voulons surtout dire par là ou, mieux, ce qui est au fondement de ce très légitime sentiment est quelque chose qu’on pourrait appeler, en langage académique, la « structure intentionnelle négative de notre travail actuel ». Je ne veux pas seulement signifier que nous ne sommes pas propriétaires des moyens de production à l’aide desquels nous travaillons. Ce célèbre défaut n’en est qu’on parmi d’autres, qui tous sans exception sont des conséquences de la seule « révolution mondiale » ayant véritablement eu lieu au cours de ces derniers siècles : la révolution technique qui triomphe à l’Est comme à l’Ouest. Mes analyses sont donc, comme celles du premier tome [1], « indifférente aux systèmes ».
Par l’expression complexe de « structure intentionnelle négative de notre travail actuel », que j’éviterai le plus possible au cours de mon enquête, je désigne le fait que pendant le travail (à la différence de l’artisan, du cordonnier par exemple, qui sait et voit ce qu’il fait et qui tout au long de son activité travaille en vue d’un produit fini dont il possède déjà une image), nous ne voyons pas devant nous le produit fini que nous fabriquons (ou plutôt dont nous co-fabriquons des éléments et des éléments d’éléments), le fait que durant ce temps, nous restons sans « eidos » et « transcendants » aux produits.
C’est le cas :
- 1. parce que le chemin entre notre premier geste sur la chaîne et le produit définitif de cette chaîne est infiniment médiatisé ;
- 2. parce que dans « notre » produit entrent aussi de nombreuses opérations d’autres ouvriers et qu’à travers ces broussailles, nous ne distinguons pas notre propre contribution de celle des autres. En fait, essayer de penser au produit final pendant que l’on travaille sur la chaîne serait stupide. Comme nous ne pouvons plus régler notre propre contribution en fonction de ce que doit être le produit final, notre relation à celui-ci reste une relation purement extérieure, une relation qu’on ne connaît que par « ouïe-dire » ;
- 3. parce que nous devons nous concentrer sur la partie de partie à laquelle il nous incombe de travailler et sur l’instant présent de ce travail ; parce qu’il le faut absolument pour pouvoir travailler avec précision ; et, finalement parce que nous le voulons ;
- 4. parce qu’il ne doit pas nous venir à l’idée de juger, de critiquer, voire de saboter « nos » produits (et surtout pas leur finalité) – ce que nous ne devons pas seulement nous abstenir de faire, mais ce que nous voulons derechef nous abstenir de faire. Et si nous le voulons, c’est très précisément parce qu’en période de chômage [2], nous nous saboterions du même coup.
Manifestement, l’« absence d’eidos » et la « transcendance » – qui, même si elles n’ont pas été nommées, existent depuis plus d’un siècle – sont tout sauf des qualités simplement contingentes et empiriquement constatables du travail et de la production. Elles sont plutôt, puisqu’elles viennent de l’irrévocable révolution industrielle, des symptômes essentiels de notre travail actuel, contre lesquels il n’y a pas de remède. Voilà pourquoi le discours omniprésent en faveur de l’éventuelle « humanisation du travail » n’est qu’un verbiage malhonnête, une contradictio in adjecto [3]. Il peut tout aussi peu y avoir une humanisation du travail qu’une humanisation de la guerre, parce que ce qu’on prétend humaniser contient d’avance, dans un cas comme dans l’autre, le principe de l’inhumanité.
Mais il ne faut pas en rester à cette « absence d’eidos » et à cette « transcendance au produit ». La négativité opère bien plus largement . Nous ne sommes pas exclus seulement des images de nos produits, mais aussi de la liberté de disposer de l’usage que nous en ferons. Et nous sommes derechef exclus de la possibilité de juger des effets (qui parfois vont jusqu’au génocide) de nos produits (c’est à dire des effets de notre production, effets dont nous sommes la cause) et d’en assumer la responsabilité. Et comme nous l’avons dit, non seulement nous ne pouvons pas faire tout cela, mais nous ne le devons pas non plus. Et nous ne devons pas seulement ne pas le pouvoir, nous ne devons plus vouloir le pouvoir. Bref, nous ne le faisons pas. Le produit de notre travail ne nous concerne pas.
Cette « transcendance au produit », à l’usage, aux effets nous est imposée, mais nous l’acceptons aussi comme évidente et innocente. Le fossé infiniment large entre notre activité et les effets qu’elle peut avoir n’importe quand et n’importe où, rend notre vie – et nous voilà dans le sujet – effectivement absurde. S’il peut encore être question d’un « sens du travail », celui-ci se réduit désormais – je ne le dis pas dans une intention méprisante – au fait de recevoir sa paye. Puisque la majorité de nos contemporains vivant dans les pays hautement industrialisés ne connaissent que ce sens, ne peuvent plus connaître que lui, nous devons dire de cette majorité qu’elle mène une vie absurde. Ayant dit cela, nous devons reconnaître qu’il est peut-être plus sensé, non, plus supportable, d’avoir un « travail absurde » que de végéter de façon absurde comme les chômeurs qui n’ont pas encore le plaisir d’avoir un « travail absurde ». Rien ne me brise plus le cœur que la nostalgie des chômeurs pour le bon vieux temps où ils pouvaient encore travailler de façon absurde.
2. L’univers des moyens
La seconde cause de notre sentiment d’absurdité est le fait que nous sommes condamnés à vivre dans un « univers de moyens ». Avec cette expression, je vise le monde artificiel, créé par la deuxième révolution industrielle, dans lequel il n’y a plus un acte ni un objet qui ne soient des moyens, qui ne doivent être des moyens, dont le but ne doive consister à assurer la production ou la maintenance d’autres moyens – des moyens dont le but consiste à son tout à produire d’autres moyens ou à les rendre nécessaires, etc. Un acte ou un produit n’acquiert une « valeur » qu’à condition d’être « bon à quelque chose », c’est-à-dire seulement lorsqu’il a un sens et non lorsqu’il est un sens. Employer ici l’adverbe « seulement » n’est toutefois pas recevable parce qu’être un moyen pour quelque chose est la plus haute, la seule justification de l’existence [4]. Les fins ultimes n’avaient donc – pour autant que de telles fins puissent apparaître dans l’univers des moyens (ce qui n’est jamais le cas) – aucun « sens », elles étaient « absurdes » (c’est en cela que consiste la dialectique de l’absurdité). Au mieux, on pourrait considérer les fins ultimes comme le « sens des moyens », puisque c’est elles que ces dernières cherchent à réaliser. Cet univers est donc absurde globalement, en tant que tout, puisqu’en lui tout n’est que moyen et rien n’est but. Et la contrainte de ne pouvoir éviter de vivre dans un univers à ce point absurde est, elle aussi, absurde.
- II -
Le refoulement du « vide de sens »
Tournons-nous maintenant, après avoir dégagé les deux sources de l’absurdité, vers les moyens grâce auxquels on tente d’y remédier. Il y en a deux : l’aide qui vient de l’extérieur et l’aide qui vient de soi.
3. L’aide qui vient de l’extérieur
Toute personne qui se contente de feuilleter la littérature portant sur ce sujet devrait être déconcertée (ce n’est pas mon cas) par le fait qu’il n’y est que très rarement – voire jamais – question de l’absurdité effective de notre vie, mais toujours seulement du sentiment de l’absurdité, comme si ce sentiment était le véritable malheur et qu’il faille l’écarter ; comme si la douleur dentaire était la maladie. Chez aucun auteur on ne trouve écrit noir sur blanc : « Oui, notre vie est effectivement absurde. » Aucun auteur ne se demande si le désir de sens est sensé ou non.
Ce n’est bien sûr pas sans raison qu’il en va ainsi. Car il est évident que quelqu’un qui reconnaîtrait l’absurdité comme un fait, prendrait ses distances avec la technique (qui nous l’avons vu est la source d’absurdité) et, en outre, que toute entreprise – de ce côté-ci ou de celui-là du rideau de fer – qui prendrait ses distances avec la technique, serait par là même condamnée à mort. Ainsi, l’absurdité est presque entièrement refoulée. Et cela pas seulement par les entreprises qui fournissent les emplois mais aussi par les millions d’ouvriers, puisque ceux-ci, s’ils regardaient en face l’absurdité de leur travail et de leur vie, devraient tout abandonner. En fait, le nombre des hommes sincères, ceux qui reconnaissent l’absurdité – nous allons bientôt parler d’eux –, est incomparablement plus faible que le nombre de ceux qui la refoulent. Ceux-ci – il s’agit de centaines de millions – affirment très naturellement (et ceux qui sont menacés par le chômage et les chômeurs effectifs de la façon la plus emphatique) que le travail est en tant que tel est pour eux un droit fondamental et sacré. Et puisqu’il serait insensé à leurs yeux de désigner comme absurde quelque chose dont ils proclament que c’est un droit sacré, ils s’empêchent avec succès de reconnaître l’absurdité de leur travail. Quand on la leur rappelle, ils ne peuvent tout simplement plus s’approprier la vérité biblique selon laquelle le travail, même le plus absurde – celui qui permet d’apaiser les besoins immédiats –, a été regardé, des origines jusqu’à une date très récente comme une malédiction, et cela même si leur propre travail est « maudit » comme l’a été tout travail humain jusqu’à présent. S’il en est ainsi, c’est parce qu’ils sont incapables de ressentir quelque chose à la fois comme « positif » – à savoir comme sacré – et comme « négatif » – à savoir comme absurde et comme une malédiction.
--continue read
http://www.non-fides.fr/?L-obsolescence-du-sens


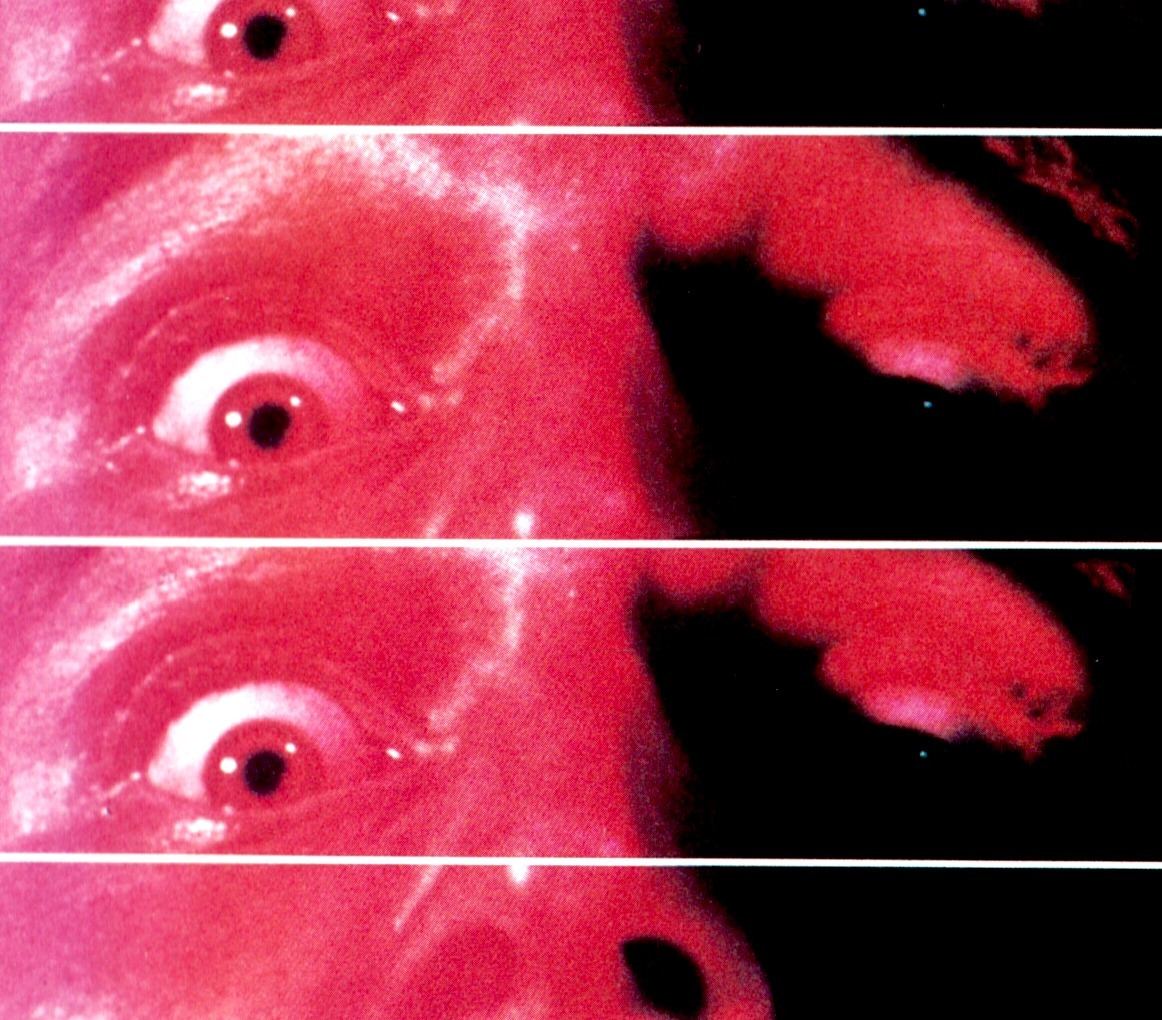
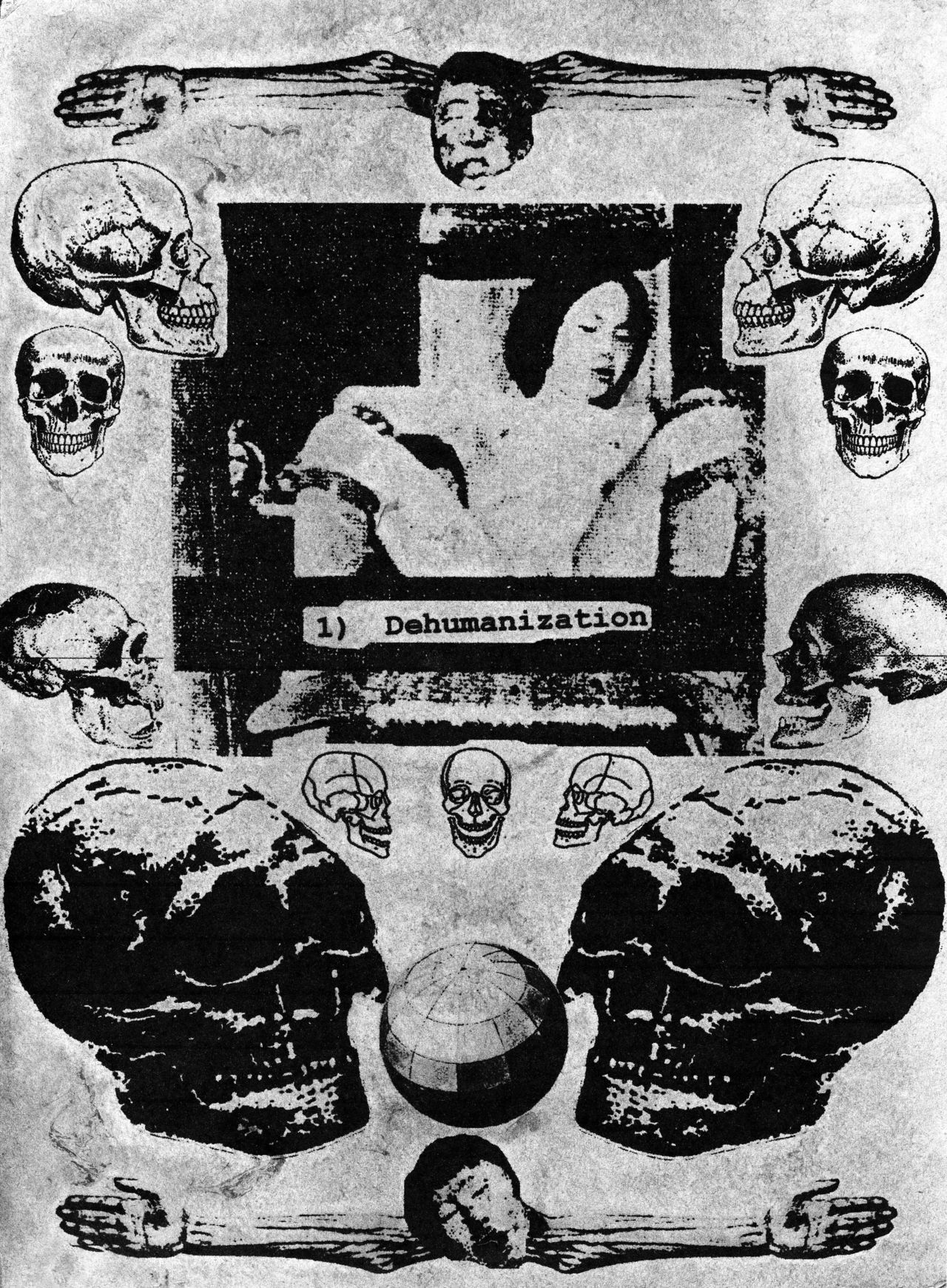



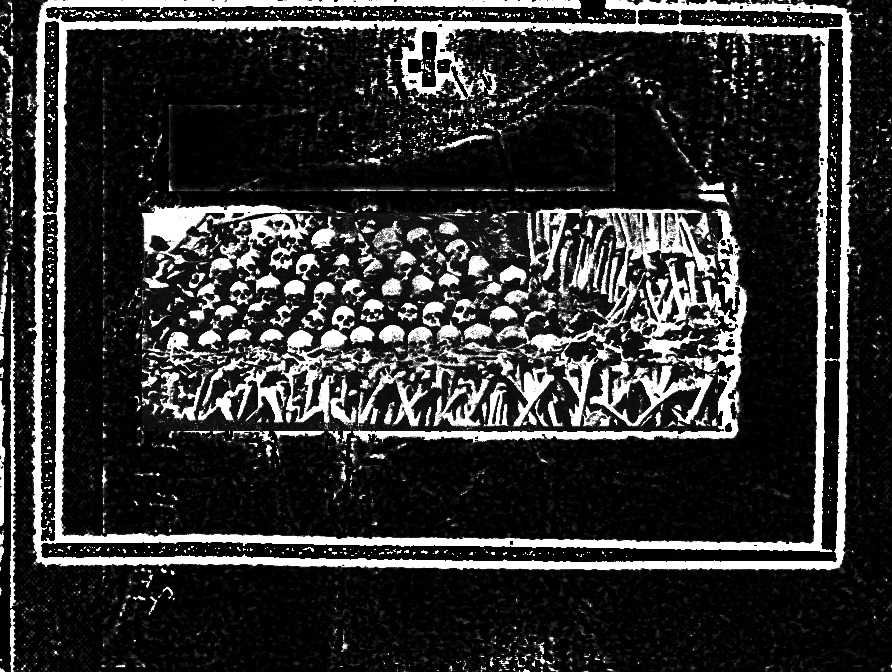




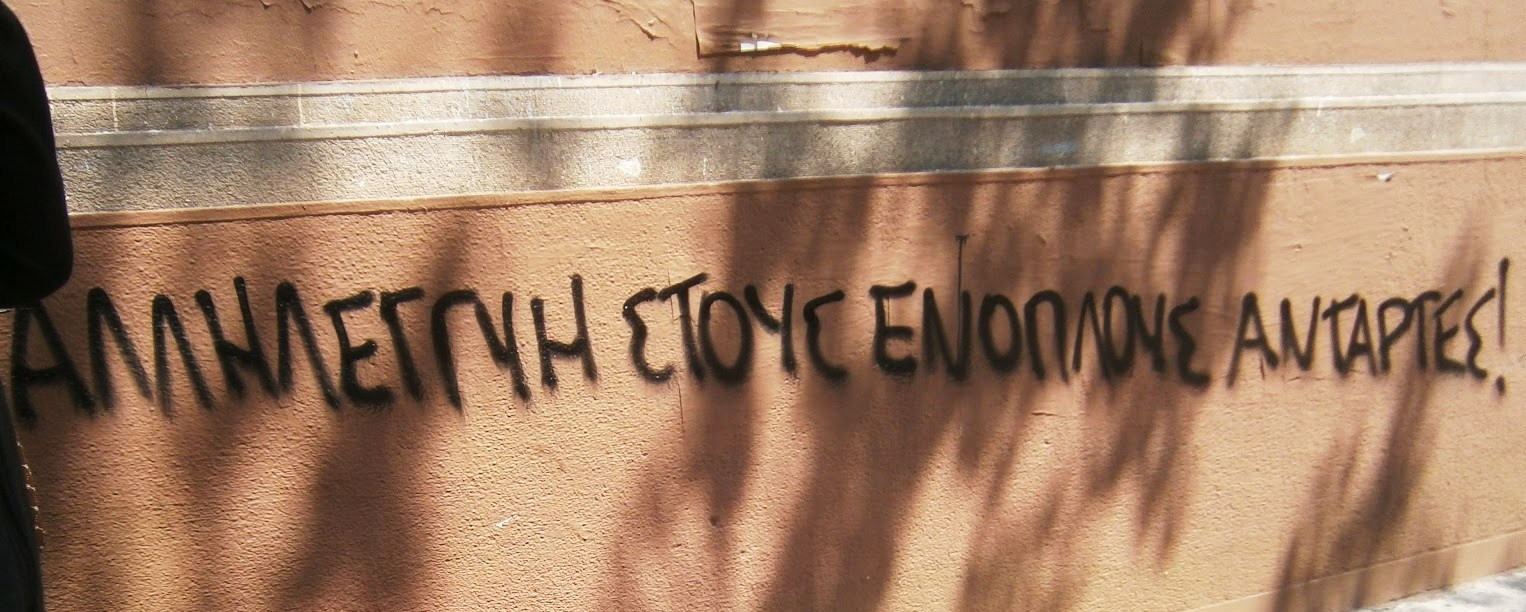

![Eurorepressione - Sulla conferenza a Den Haag sul tema "Anarchia" [corretto]](http://25.media.tumblr.com/tumblr_m0jvngOXtY1qa2163o1_1280.jpg)



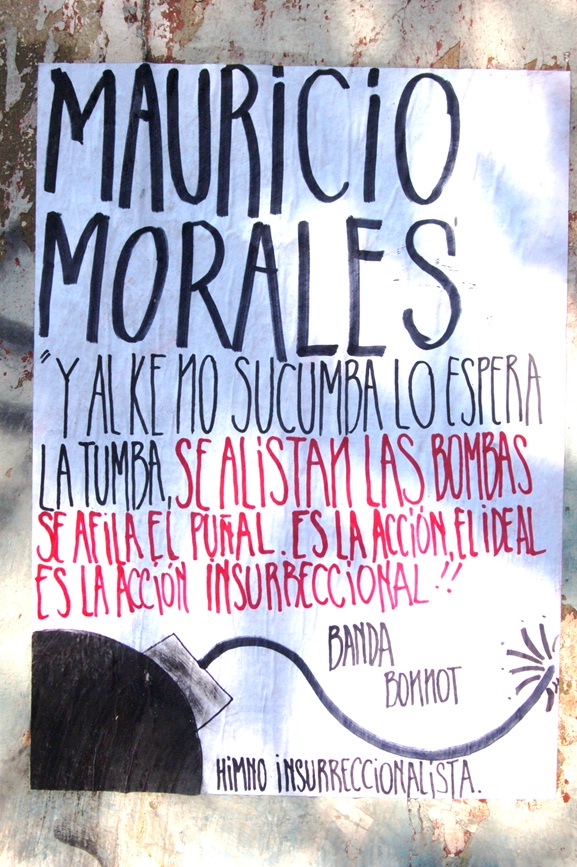
![A tres años de la Partida de Mauricio Morales: De la Memoria a la Calle [Stgo.]](http://metiendoruido.com/wp-content/uploads/2012/05/mmacividad.jpg)









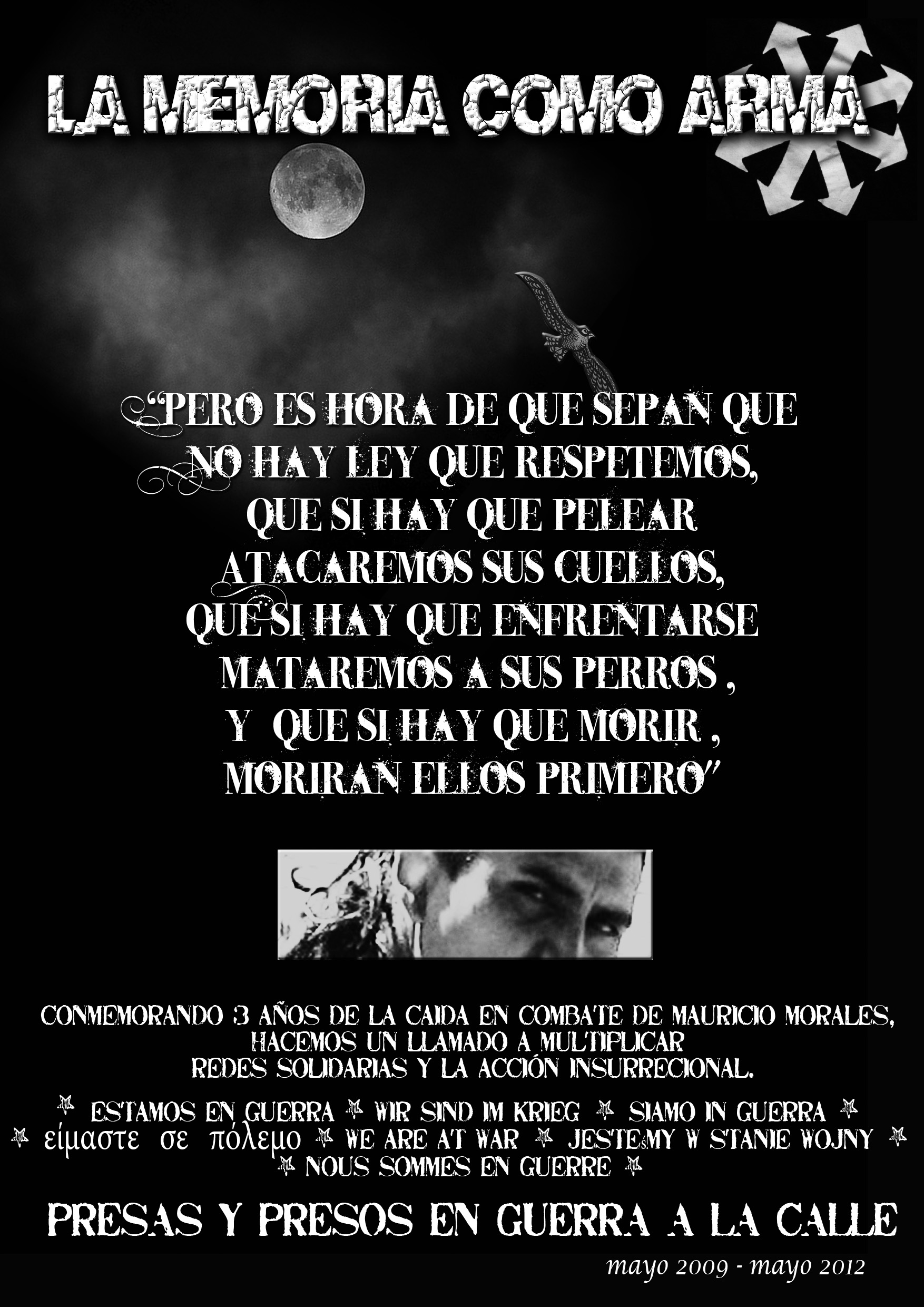









Nessun commento:
Posta un commento